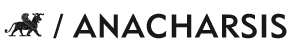14 octobre 2021 | Actualités
Hommage. Alban Bensa, « La Grande Montagne »
Il est difficile d’écrire sous le coup de l’émotion. Quand le chagrin infuse encore et noie le discernement. Et encore plus difficile d’écrire au passé à propos d’un ami tout juste disparu. Il n’en reste pas moins qu’il faut saluer Alban Bensa.
Notre rencontre s’est opérée il y a plus de quinze ans, sous des auspices à fronts renversés : il s’agissait de publier les mémoires d’un obscur canonnier français « entré en littérature par effraction » afin de raconter la répression de la grande insurrection kanak de 1878 en Nouvelle-Calédonie.
Alban avait décelé chez cet homme illettré une improbable mais saisissante qualité d’écriture. Pour autant, il restait modérément enclin à se lancer dans pareille aventure éditoriale, par trop univoque. Mais lorsque nous lui avons suggéré de placer en regard des écrits du soldat colonial un récit proprement kanak sur cette « Guerre d’Ataï », il s’est illuminé. C’est ainsi qu’est né ce premier livre bizarre : « 1878. Carnets de campagne en Nouvelle Calédonie, de Michel Millet, précédé de La guerre d’Ataï, récit kanak ». L’affaire était lancée ; elle allait durer jusqu’au bout.
L’implication d’Alban aux éditions Anacharsis est rapidement devenue massive et foisonnante. C’est au projet dans son ensemble qu’il a adhéré, au point de prendre une part active dans l’élaboration du catalogue avec un enthousiasme et une joie qui ne se sont jamais démentis. Nous lui devons non seulement certains de nos titres les plus emblématiques, mais encore des heures de conversations passionnées, chez lui à Paris ou en Bretagne, à Toulouse ou Marseille, sur un mode espiègle souvent, ponctuées à l’occasion de phases hilarantes qui n’ont pourtant guère entravé la consistance des travaux que nous avons menés en commun.
Il possédait cette immense curiosité qui le faisait s’intéresser également aux sagas islandaises et à l’histoire des Indiens des Grands Lacs, aux poèmes de Mallarmé comme aux épopées homériques, à la linguistique autant qu’aux mécanismes du politique. Et bien sûr à cette anthropologie critique que nous avons défendue avec lui et d’autres, et qui suppose de mettre à bas le funeste miroir exotique au bénéfice d’un retour au réel ancré dans l’apprentissage réciproque niché au cœur d’une rencontre. « C’est nous qui nous croyons autres pour mieux imaginer une altérité qui se dissout au premier rire avec celles et ceux que nous ne connaissions pas », disait-il dans La fin de l’exotisme.
Fort de ce principe, il attribuait une dignité égale à tous ses interlocuteurs. Jusqu’à concevoir, avec Kacué Yvon Goromoedo et Adrian Muckle, un autre livre « bizarre » – et colossal –, Les Sanglots de l’aigle pêcheur. Nouvelle-Calédonie : la guerre kanak de 1917, qu’il regardait comme son œuvre majeure. La dimension polyphonique de ce travail laisse voir à quel point il restait attaché à la parole collective, qu’elle soit écrite ou orale – amplifiée par exemple par le jeune slameur Paul Wamo –, qu’il savait solliciter puis laisser courir. C’est que sa lutte de chaque instant en faveur de l’indépendance de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, fruit d’une connivence étirée sur cinquante ans de compagnonnage avec les militants, était profondément nourrie par son travail de terrain, par où il administrait la preuve que l’engagement peut être partie prenante, et non une entrave, de la connaissance scientifique.

Alban avait ainsi chevillée au corps la combativité du rugbyman qu’il avait été, accompagnée d’une constante fidélité à ses causes et ses amitiés qu’il a su, et voulu, mener sans jamais fléchir. Il était de ces hommes qui ne rechignent pas à s’exposer dans la mêlée, noués à d’autres par les bras et le torse pour mieux faire front. Et en dépit de ses inénarrables retards de remise de copies – un problème avec la temporalité, sans doute –, la dette des éditions Anacharsis envers Alban Bensa reste prodigieuse.
Les Hurons avaient un nom pour désigner le père prodigue qui dispensait avec une générosité sans frein à ses nombreux enfants ses richesses infinies : Onontio, « La Grande Montagne ».
Salut Alban.
Charles-Henri Lavielle et Frantz Olivié – éditions Anacharsis